« S’inscrivant dans le champ de l’action sociale et l’histoire du travail social , l’ingénierie sociale est entendue comme une démarche collective et territorialisée de transformation sociale pour plus de solidarité et de justice sociale, alliant :
-recherche, production de connaissances issues d’un dialogue et une confrontation de différents types de savoirs (expérientiels, professionnels et scientifiques) ;
-prospective et ingénierie de projet ;
-mobilisation pluri-acteurs dont les personnes et populations concernées. »
ANDELIS, 2023
« Par ingénierie sociale, nous entendons une démarche collective d’action et de compréhension contextualisée, incluant les personnes accompagnées elles-mêmes. Elle s’appuie sur un faisceau de compétences et d’outils conceptuels et méthodologiques. Elle permet de piloter, co-construire, accompagner et évaluer les dispositifs et organisations de l’intervention sociale, dans une visée de justice sociale. »
ANDELIS 2016
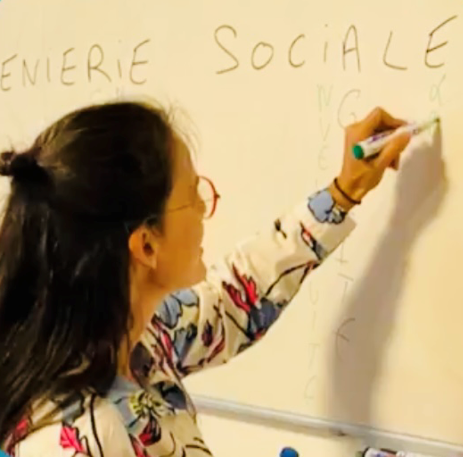
« (…) la résolution des problèmes sociaux n’est pas réductible à la question des compétences des intervenants sociaux ou à une expertise technique et professionnelle possédée par quelques-uns. Nous pensons qu’il s’agit d’un enjeu de société dont le traitement réclame la formation d’une expertise collective élaborée dans le cadre d’un débat démocratique.
Autrement dit, la question sociale devient un problème de gouvernance démocratique et territoriale appuyée sur des compétences collectives. L’ingénierie sociale peut être définie à partir de cet espace générateur de gouvernance démocratique territoriale dans la conception et la mise en œuvre de politiques publiques ; la production de compétences collectives par la production de connaissances et d’actions publiques. Dans cette perspective, l’ingénierie sociale doit, de notre point de vue, intégrer à son projet et à ses méthodes des logiques collectives, expérimentales, et contribuer ainsi à générer des réponses appropriées, voire novatrices, validées démocratiquement. »
Alain Penven, L’ingénierie sociale, 2013, Éditions Érès
« L’ingénierie sociale peut se définir comme une fonction d’ensemblier ou d’ « assemblier » qui se situe dans la pratique, l’action, l’intervention, et apporte, ou aide à trouver, des solutions pour favoriser la résolution de problèmes dans un champ « sociétal ». Alors que les administrations et les services, voire les organisations du secteur privé, sont structurés sur un modèle de tuyau d’orgue, l’ingénierie sociale doit aller chercher, aider à regrouper, et utiliser des outils, des techniques qui peuvent venir d’univers différents. Mieux, elle doit contribuer à rapprocher, à mailler des services et des organisations différentes (…) Exprimé différemment et selon Georges Gontcharoff, « l’ingénierie (sociale) est d’abord un art combinatoire, jouant dans la pluridisciplinarité et dans l’interinstitutionnel. De même qu’un ingénieur technique sait combiner et faire collaborer tous les corps de métier concourant à une même œuvre, l’ingénieur social est un diplomate, capable de faire travailler tous les acteurs si divers et si exclusifs ensemble, en respectant la légitimité de chacun. On peut dire que c’est un agent de passage du sectoriel au global ». L’ingénierie sociale sollicite la notion de compétence collective, la mobilisation des savoirs (savoirs académiques, connaissance des politiques et des dispositifs, connaissance de terrain et des acteurs). »
Rapport Morel, 2008
(G. Gontcharoff fut un responsable politique et associatif français, acteur du développement social et des politiques de décentralisation ; a travaillé au Ministère de la solidarité nationale au début des années 1980)
« Un ensemble de méthodes et de compétences qui visent à aider les acteurs locaux, les associations, les usagers des équipements et des services publics à conduire des actions permettant d’améliorer les conditions de vie, développer des réseaux de solidarité, gérer les conflits sociaux. Plus qu’un savoir-faire, il s’agit d’un savoir faire-faire. L’ingénierie sociale recouvre des capacités de diagnostic ; d’organisation, de négociation et d’évaluation mises à la disposition des acteurs locaux pour favoriser le développement des initiatives et soutenir leur mise en œuvre en vue de dynamiser la vie sociale. L’ingénierie proprement dite ne consiste pas à réaliser ces actions, mais à créer les conditions, mobiliser les moyens, construire des dispositifs, pour exploiter les potentialités économiques, sociales et urbaines d’un site, et développer les capacités des acteurs. Il s’agit donc d’une fonction d’appui logistique et d’assistance méthodologique aux acteurs. »
Vincent de Gaulejac, Jean Fraisse et Michel Bonetti, L’ingénierie sociale, 1995, Éditions Syros